Les badiénou gokh, des « marraines de quartier » pour parler sexe et contraception
Pour pallier ce manque, le gouvernement sénégalais a mis en place depuis 10 ans un système de « marraines de quartier » : les badiénou gokh. J’ai rencontré Mme Ngone Sarr, qui est Présidente des badiénou gokh dans l’un districts de Dakar.
« L’expression « badiénou gokh » au Sénégal représente la sœur du papa, c’est la tante qui a la naissance du bébé le porte avant qu’on lui donne son nom.
C’est la badiénou gokh qui, si c’est un garçon, l’amène pour la circoncision, c’est la badiénou gokh aussi qui si, c’est une fille qui se marie, l’emmène chez son mari… »
Ce nom a donc été donné à ce corps de femmes construit comme un réseau d’appui aux structures de santé reproductive, elles sont l’intermédiaire entre ceux-ci et leurs communautés.
« Encore aujourd’hui, il y a des femmes qui accouchent dans les maisons, qui ne font pas leurs consultations pré-natales et post-natales, ni vacciner leurs enfants… Donc c’est pour éradiquer ces problèmes qu’on a créé le concept de badiénou gokh. »
Au début, il s’agissait essentiellement d’agir auprès des femmes enceintes.

Mais depuis peu, Mme Ngone Sarr explique intervenir aussi sur l’enregistrement des naissances : au Sénégal, beaucoup d’enfants ne sont pas déclarés et parviennent à l’âge de 11 ans sans pouvoir passer l’examen d’entrée en 6ème faute d’avoir une identité officielle. Mais surtout, elle a pris le parti de s’engager auprès des jeunes depuis le départ.
« Je travaille beaucoup sur la santé de la reproduction des ados et des jeunes, sur la planification familiale. Ici, on m’appelle « la badiénou des jeunes ». C’est aussi parce qu’avant, j’ai longtemps travaillé en tant qu’éducatrice pour les enfants. »
Sensibilisation, accompagnement : les badiénou gokh sur tous les fronts
Pendant 12 ans, elle a officié dans le domaine de la protection maternelle et infantile, en plus d’avoir été un relai entre autorités et population. Une position qui en a faite une femme toute désignée pour endosser le rôle de badiénou gokh.
« Ce n’est pas seulement une personne connue dans sa communauté, mais reconnue par la société pour son leadership, son charisme, sa discrétion », m’explique Mme Ngone Sarr.
Son travail est d’être une confidente disponible et de confiance.
« Parfois, ce sont les femmes qui nous sollicitent, ou leurs maris, leurs belles-mères. Mais souvent aussi, ce peut être nous qui repérons dans la rue une femme enceinte et qui l’abordons pour savoir si elle est bien suivie. »
Pour les jeunes, la stratégie est similaire.
« On organise des activités de sensibilisation, sur la santé reproductive, les IST, le VIH. On fait des causeries, des entretiens individuels, des visites à domiciles et on partage beaucoup de choses avec eux. »
Très concrètement, il leur arrive par exemple de repérer un groupe d’ami·es dans la rue et de les inviter au centre de santé pour leur donner les bases en matière de santé sexuelle et reproductive.

Mais elles font aussi du porte à porte, se rendent dans les centres communautaires où les jeunes ont coutume de se retrouver le mercredi après-midi, voire dans les collèges et les lycées.
« De plus en plus, ils se déplacent pour venir vers nous car on leur donne aussi des préservatifs s’ils en ont besoin. »
« Ne pas juger » pour préserver une relation de confiance avec les ados
Au Sénégal, l’abstinence avant le mariage est fortement promue.
« Mais si un jeune veut s’essayer à la sexualité, tu ne peux pas l’en empêcher. Alors autant l’aider à se protéger. »
Elles sont les référentes en la matière.
« Si une jeune femme veut avoir recours à la planification familiale, elle peut venir nous trouver. Souvent, on les emmène dans des structures de santé où elles ne sont pas connues pour ne pas être stigmatisées.
Elles s’adressent à nous car elles ne peuvent pas en parler à leurs parents. On essaie d’utiliser le même langage qu’elles, de ne pas les juger, d’avoir de l’empathie et de donner des conseils. Ne pas juger, c’est vraiment important. »
Il arrive aussi que ce soit les parents eux-mêmes qui viennent demander l’aide des badiénou gokh pour intervenir auprès de leurs enfants.
« Il y a autant de garçons que de filles qui participent. Parce que faire un enfant c’est un choix. Les garçons aussi, maintenant ils sont bien sensibilisés pour savoir que c’est deux personnes qui font un enfant, un homme et une femme.
Donc c’est une charge pour un garçon qui est au collège et au lycée. Avant, on obligeait les garçons qui ont des enfants, même jeunes, à se marier. C’était des mariages forcés, les enfants n’étaient pas prêts. Maintenant, ils préfèrent se protéger plutôt que d’avoir un mariage ou bien des enfants non désirés. »
L’interdiction de l’avortement, encore et toujours
Il arrive pourtant encore à Mme Ngone Sarr de devoir prendre en charge des jeunes filles, enceintes à l’âge de 13 ou 14 ans.
« Parfois, elles nous parlent de viol. On les emmène alors dans des structures comme l’association des femmes juristes ou bien au sein des services de violences infantiles et familiales.
Ils nous aident pour la prise en charge qui peut être financière, judiciaire, psychologique s’il le faut, mais dans tous les cas, c’est difficile pour une fille de 13 ans d’accoucher normalement. »
Selon l’OMS« les complications de la grossesse et de l’accouchement sont la deuxième cause de décès chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans dans le monde ».
Malgré tout, elles sont accompagnées comme les autres femmes enceintes.
« Elles abordent parfois l’avortement, pas directement mais elles essaient de savoir si c’est possible. Nous, comme c’est interdit on n’ose pas – si on pouvait, on serait pour l’IVG surtout pour les grossesses issues d’incestes. »
À défaut, elles essaient de soutenir le mieux possible ces jeunes filles-mères :
« Au niveau du district, on a la chance d’avoir l’accouchement humanisé. C’est une prise en charge des femmes enceintes vraiment plus humaine, la femme peut être accompagnée par son mari, sa maman, sa sœur ou une personne de confiance jusqu’à l’accouchement. »
Il arrive tout de même que des jeunes filles « prennent des herbes pour avorter » : des mixtures qui leur créent souvent des problèmes de santé.
« Parfois elles sont obligées d’aller dans les structures sanitaires mais certaines sages-femmes appellent la police… »
Cependant Mme Ngone Sarr reste optimiste :
« Ça tend à être de moins en moins fréquent car il y a la planification, l’espacement des naissances, la sensibilisation. Donc les filles savent comment faire pour se protéger. »
Badiénou Gokh, une tâche à plein temps et… bénévole

Des badiénou gokh ont été nommées dans chaque communauté, pas seulement dans les grandes villes. Elles y font le même travail que leurs consœurs urbaines, bien qu’elles soient moins nombreuses : il faut parfois se rendre au village voisin, à plusieurs kilomètres, pour les rencontrer.
Pour toutes, c’est un « travail bénévole ». Elles ne sont pas payées pour la mission qu’elles accomplissent, ce qui rend parfois le quotidien difficile pour ces femmes.
« J’ai travaillé pendant 12 ans en tant qu’éducatrice mais finalement j’ai arrêté car je ne pouvais pas faire les deux. Parfois, on est obligées d’accompagner les femmes à 2h, 3h du matin, ou pour leurs consultations, pour la vaccination…
On est tellement sollicitées qu’on ne peut pas faire un autre travail bien que ce soit un travail bénévole. »
Il arrive que les badiénou gokh soient rémunérées par les partenaires avec qui elles mettent en place des activités comme des ONG ou institutions internationales.
Mais la plupart du temps pour gagner de quoi vivre, Mme Ngone Sarr fait « du petit commerce ». Encens, tissus… elle transporte le tout dans son sac à main et revend au fur et à mesure à des particuliers.
« C’est vrai que ce n’est pas tous les jours facile. »
D’autant moins que les badiénou gokh ne sont pas non plus subventionnées dans leurs activités.
« On n’a pas de caisse pour pouvoir appuyer les gens auprès desquels on intervient. Ça pose des problèmes de moyens : peut-être que l’État n’a pas de quoi donner des subventions à tout le monde mais les populations croient qu’on dispose de ces moyens.
Parfois on est obligées de prendre nos propres revenus pour aider les communautés. »
Des progrès qui rendent le bénévolat supportable
Malgré la difficulté de la tâche, Mme Ngone Sarr continue de s’y consacrer avec enthousiasme car elle constate les progrès accomplis.
Lorsque je la laisse, elle s’apprête justement à assister à une réunion pour tous les partenaires travaillant sur le thème du VIH.
« Les transmissions ont beaucoup diminuer ces dernières années ici, même s’il reste des améliorations à apporter. »
Des efforts qu’elle et son groupe de badiénou gokh ne rechignent pas à fournir, au quotidien, pour rendre celui des autres plus supportables.



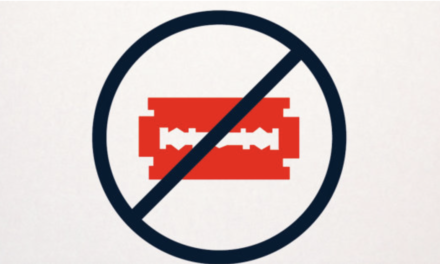



Commentaires récents