« L’idée qu’une femme peut interrompre sa grossesse n’est toujours pas acceptée en RDC » déclare, dans une interview au quotidien Le Monde, Anny Modi, la Directrice de l’ONG congolaise Afia Mama, qui milite contre les violences sexuelles faites aux femmes et pour qu’elles puissent disposer librement de leur corps.
La loi est claire. L’article 166 du code pénal de la République démocratique du Congo (RDC) condamne « la femme qui volontairement se sera fait avorter à une servitude pénale [peine de prison] de cinq à dix ans ». Juste au-dessus, l’article 165 stipule que « celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme, sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. » Rien d’autre. Pas un mot de plus, aucun alinéa ni exception…
Si l’interruption volontaire de grossesse (IVG) reste pénalement répréhensible en RDC, elle ne devrait toutefois plus être sanctionnée. Soutenue par plusieurs ONG dont Médecins du monde, la société civile congolaise qui défend les droits des femmes s’appuie en effet sur un autre texte, le Protocole de Maputo, qui n’est autre qu’un complément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Entré en vigueur après sa publication au Journal officiel de RDC en mars 2018, cet accord se présente comme un instrument juridique qui autorise « l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie du fœtus ».
Agée de 37 ans, Anny Modi est la présidente d’Afia Mama (« la santé de la femme » en swahili), une ONG féministe qui lutte notamment aux côtés du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, contre les violences sexuelles faites aux femmes. Ancienne réfugiée devenue membre du réseau des femmes leaders africaines, Anny Modi rappelle, avant la journée mondiale du droit à l’avortement, samedi 28 septembre, que les femmes doivent pouvoir disposer librement de leur corps dans un pays où, selon plusieurs ONG, six grossesses sur dix ne sont pas désirées.
Quelle est aujourd’hui la condition des femmes en RDC ?
Elle est très fragile parce que l’accès des femmes aux services sociaux de base est très limité. Les femmes ne décident pas de leurs propres priorités alors que le cadre légal leur garantit de nombreux droits. Les causes sont nombreuses, des normes sociales au manque de vulgarisation des lois en vigueur. Dans les grandes villes, nous avons des magistrats qui connaissent les lois [et le devoir d’application du Protocole de Maputo], mais plus on s’éloigne des centres urbains et moins la législation est connue. Les femmes ne peuvent donc pas y bénéficier des évolutions du cadre législatif qui restent méconnues. Il faut également prendre en compte le manque d’infrastructures. Une femme peut légalement accéder aux services sanitaires, mais s’il n’existe pas d’hôpitaux ou qu’il n’y a pas de médecins, elle ne peut pas recevoir de soins. A ces barrières s’ajoutent une série de mythes autour de la contraception.
Quels sont ces mythes ?
Ils disent, par exemple, que le lubrifiant des préservatifs peut donner le cancer ou d’autres maladies. Il faut savoir que, jusqu’en 2015, la femme mariée était considérée comme un enfant puisqu’elle avait besoin d’une autorisation maritale pour tout acte légal. Accéder à des moyens de contraception ne pouvait donc se faire sans l’autorisation du mari.
Certains considèrent aussi que la contraception va réduire la croissance démographique de la tribu. Or, plus un groupe ethnique compte de membres, plus il est puissant et respecté. La volonté de contrôler les naissances est donc rejetée par certaines populations.
Enfin, il faut ajouter les croyances religieuses. Les « pro-life » considèrent qu’utiliser un préservatif revient à tuer. Alors quand vous associez la culture traditionnelle à la religion, cela devient très difficile pour les femmes en RDC de manifester leur liberté. Les Congolais sont chrétiens à 90 %. Il y a les églises traditionnelles, mais aussi des centaines d’églises dites « de réveil ». Si chacune a son idéologie, sa doctrine, d’une manière générale, elles prônent le contrôle du corps de la femme et condamnent les IVG.
Des femmes sont-elles encore condamnées pour un avortement en RDC ?
L’idée qu’une femme peut interrompre sa grossesse n’est toujours pas acceptée. Dans les zones de conflit, comme au Nord-Kivu, elles sont nombreuses à souhaiter interrompre une grossesse consécutive à un viol. Même si elles en ont le droit, c’est impossible. Elles se tournent alors souvent vers des avortements clandestins dans des structures non médicalisées et avec des pratiques dangereuses parfois mortelles.
Des charlatans leur font croire que leurs méthodes ou leurs breuvages sont efficaces alors qu’ils provoquent des hémorragies pouvant se révéler mortelles. Beaucoup meurent après avoir introduit dans leur sexe des cuillères surchauffées afin d’évacuer leur bébé.
La publication du Protocole de Maputo n’aurait donc pas eu un impact sur le terrain ?
Avant sa signature, on ne pouvait même pas parler d’IVG puisque l’acte était considéré comme criminel. Depuis que le protocole est entré en vigueur, il surplombe le cadre législatif local. Mais il faut encore communiquer, comme diffuser l’information sur les chaînes de télévision nationales pour rappeler les droits des femmes et expliquer les risques graves des avortements clandestins.
Avec l’appui de nos partenaires, nous avons aussi formé des acteurs du système judiciaire. On a même pu faire adopter au Conseil supérieur de la magistrature une circulaire qui a été envoyée à toutes les instances juridiques à l’intérieur du pays pour protéger les prestataires disposés à pratiquer l’avortement. Il y a donc une évolution réelle, même si elle est lente, surtout à l’extérieur des zones urbaines.
Militez-vous en faveur d’un changement de la loi pénale ?
Oui et je participe à une délégation de femmes qui rencontre le président Félix Tshisekedi [élu en décembre 2018] tous les trois mois afin qu’il entende les problèmes que rencontrent les femmes de notre pays. Il est sensible à notre cause. Son gouvernement compte 18 % de femmes et c’est une première. Pour la première fois aussi, nous avons une femme vice-premier ministre [Elysée Munembwe Tamukumwe] et une autre [Jeanine Mabunda] à la tête de l’Assemblée nationale. Avec elles, nous pouvons diffuser notre plaidoyer avec plus d’efficacité.
Les jeunes Congolaises doivent aussi comprendre qu’elles n’ont pas que des devoirs envers la société, mais qu’elles ont aussi des droits. Si elles ne les revendiquent pas, personne ne le fera à leur place. Elles doivent s’informer car l’information donne un pouvoir. Si une jeune femme ne veut pas garder son enfant car il est le résultat d’un viol par exemple, elle en a désormais le droit.
Photo de titre : Anny Modi, directrice de l’ONG féministe Afia Mama, en septembre 2019 à Kinshasa. OLIVIER PAPEGNIES / COLLECTIF HUMA



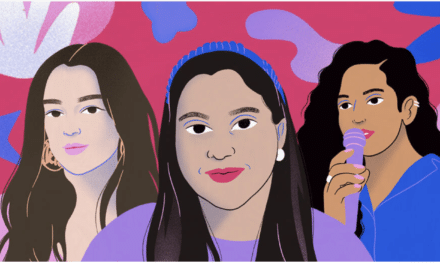




Commentaires récents