Au Sénégal, l’accès à l’avortement et à la contraception sont plus que compliqués. Esther en a discuté avec quatre jeunes filles de milieu rural. Ensemble, elles explorent l’impact sur leurs vies qu’ont de telles restrictions.
Il y a Safia*, qui a la discussion relativement facile. Et puis il y a Rania*, Anissa*, Samia*. Avec elles trois, je bataille un peu plus pour briser la glace. Elles m’ont affirmé que je pouvais leur poser tout un tas de questions, mais elles ont du mal à y répondre, en tous cas avec une voix assurée.
Il faut dire que notre discussion aborde un sujet « légèrement » sensible : je suis venue parler d’avortement avec ces quatre jeunes filles, dans un village de Casamance – une région au sud du Sénégal. Sensées être prévenues, il s’avère qu’elles ne l’étaient pas vraiment.
Alors je prends des pincettes. Plein. Je rappelle que je vais m’efforcer d’être la moins maladroite possible, qu’elles ont le droit de ne pas répondre à mes questions, que si je dépasse leurs limites il suffit de me le signaler.
L’avortement, un sujet illégal au Sénégal
L’avortement ici n’est pas seulement tabou, il est illégal. Peu importe les circonstances – c’est à dire y compris en cas de viol, d’inceste, de malformation du fœtus ou de danger pour la vie de la mère.
L’article 305 du code pénal est formulé ainsi :
« Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs. […] »
La sanction pour une femme qui perpétuerait un avortement sur elle—même va de six mois à deux ans de prison, assortie d’une amende de 20.000 à 100.000 francs.
Le Guttmacher Institute indique cependant que « le code de déontologie des médecins autorise l’avortement si trois confrères attestent la nécessité de la procédure pour sauver la vie de la femme enceinte ».
Amysakho, membre de l’Association des juristes sénégalaises m’informe que « même le fait de défendre le droit à l’avortement est censé être rendu illégal par l’article 305 bis ».
En pratique cependant, l’association se bat depuis des années sans être traînée en justice – il est évident qu’elles remporteraient le procès car cela contrevient aux normes internationales ratifiées par le Sénégal.
Mais dans ce contexte, débarquer un micro à la main pour savoir qui a avorté et dans quelles conditions n’est bien sûr pas chose aisée.
En fait, au moment où j’entame la discussion individuellement avec elles, je ne le sais pas encore, mais aucune des quatre jeunes filles que je rencontre aujourd’hui n’a eu recours à l’avortement.
La religion, première barrière contre l’IVG légalisée ?
Et lorsque je leur demande si elle pense que ça devrait être légal, elles sont unanimes : non.
« Avorter, ce n’est pas bien. C’est contraire à la religion. »
Les quatre, sans s’être concertées puisque je discute individuellement avec elles, tiennent ce discours quasiment au mot près. Elles sont musulmanes, comme 96,1% des sénégalais et sénégalaises.
Marième N’Diaye, chargée de recherche au CNRS/ISP travaillant précisément sur l’interaction Islam/avortement m’explique cependant que la relation entre Islam et avortement est ambiguë :
« Contrairement à l’Église catholique qui considère que dès qu’il y a fécondation il y a vie, les choses peuvent varier en Islam – attention, on parle uniquement de la femme mariée. L’islam n’envisage pas le cas des relations sexuelles hors mariage.
Le Fiqh [NDLR : souvent traduit comme jurisprudence islamique] condamne l’avortement en ce qu’il consiste à tuer une âme vivante. Mais à partir de quand le fœtus est il considéré comme une âme vivante ?
Ici, les opinions diffèrent selon les écoles : âme dès la conception ou délai variable entre 40, 90 et 120 jours. […]
Cependant difficile de faire valoir ces arguments au Sénégal où le rite sunnite malékite est majoritaire. En effet la doctrine malékite est l’une des plus restrictives sur l’avortement, considérant que dès lors qu’il y a eu relations sexuelles et introduction du liquide séminal, l’avortement est impossible.
Dans leur plaidoyer pour la légalisation, les militantes se basent sur l’interprétation la plus libérale des textes religieux, qui fixe à 120 jours le moment où on peut considérer que la vie est insufflée. »
Marie-Angélique Savané, figure historique du féminisme sénégalais que j’ai rencontrée à Dakar me disait à ce sujet qu’il n’était même pas envisageable de commencer à expliquer ce discours religieux :
« Ici, il n’y a que les très érudits qui parlent l’arabe. Les gens récitent des prières, mais la grande majorité les apprend par cœur sans être capable d’interpréter le Coran. Les Imams, dans leur prêche, mêlent pour beaucoup leur morale personnelle à la religion. »
L’avortement illégal, mettant en danger la santé des femmes y ayant recours
Je décide de creuser un peu tout de même. Aucune n’a eu recours à l’avortement certes. Mais Safia a deux enfants alors qu’elle a tout juste 20 ans– ou 18 selon son état civil car elle a été déclarée deux ans après sa naissance.
« Je suis tombée enceinte la première fois à 16 ans, ma fille à quatre ans et demi maintenant. »
À lire aussi : Jeune maman à 22 ans, j’ai fait ma vie à l’envers
Mais à cette époque là, comme aujourd’hui, impossible d’avorter pour la jeune fille.
Il y a la religion, en effet, mais chez elle ce n’est pas le premier argument pour expliquer le fait de ne pas y avoir eu recours. Non, ce qui l’inquiète plus de prime abord, ce sont les méthodes disponibles :
« Le médicament là c’est mauvais, ça peut te faire vraiment du mal, en plus du bébé, tu peux mourir. »
Elle le répète plusieurs fois et elle n’a pas tort. Les mixtures utilisées pour déclencher un avortement ne sont pas réputées pour être particulièrement adaptées, mettant en danger celles qui décident coûte que coûte d’y avoir recours.
50 000 femmes perdent la vie chaque année dans le monde des suites d’un avortement effectué dans de mauvaises conditions, alors que la procédure est sans danger s’il elle est réalisée dans le cadre médical.
L’interdit social, un frein pour le droit des femmes sénégalaises à disposer de leur corps
La deuxième raison qui a empêché Safia d’y avoir recours est sociale.
« Quand tu es dans cet état, tout le monde le sait. Donc s’il n’y a pas de bébé, tout le monde sait que tu as avorté. »
Je lui demande s’il n’est pas possible de cacher une grossesse, ce à quoi elle me répond avec justesse que « ça se voit là, de toutes façons » en désignant sa poitrine, serrée dans un soutien gorge trop petit.
« Quand les gens savent, ils vont parler. Ils vont juger, dire que ce n’est pas bien. »
Même si c’était légal, de toutes façons, l’interdit religieux demeure et Safia confirme qu’elle n’y aurait pas eu recours.
Les dangers de la procédure, la pression sociale, et la religion : ces trois éléments viennent ainsi compléter l’arsenal législatif.
Des grossesses adolescentes qui pèsent lourd sur le destin des « filles-mères »
Pourtant, les grossesses de Safia n’ont pas été sans conséquences pour elle. Ses parents décédés, elle n’avait pas vraiment d’épaule sur laquelle se reposer : elle vit seulement avec son oncle et sa sœur.
Le père des enfants a reconnu sa première fille, c’est la mère de celui-ci qui s’en occupe. Mais il a refusé de reconnaître la deuxième après lui avoir demandé « de prendre le médicament », un euphémisme pour signifier le recours à l’avortement.
« J’ai refusé, pour le bébé et pour moi aussi, pour ma santé. »
Depuis cette deuxième grossesse, Safia est déscolarisée et peine à joindre les deux bouts.
« L’autre jour j’avais besoin de soin de santé, on m’a demandé 15000 Francs CFA [ndlr : environ 23 euros], je me suis mise à pleurer car je ne les avais pas. J’ai fini par trouver 10000 et un ami a complété 5000. »
À lire aussi : Malala Yousafzai franchit une nouvelle étape dans son combat pour l’éducation des filles
Elle gagne sa vie comme bonne à tout faire en faisant les repas, en attendant de pouvoir reprendre une formation d’ici quelques mois, peut-être.
Être restée à l’école après le premier enfant est déjà un exploit en soi si j’en crois Marie—Angélique Savané :
« Avant il y avait une loi qui interdisait aux jeunes filles enceintes de continuer à étudier. Un immense gâchis. On a fait changer la loi, mais dans les faits ça reste très compliqué. »
En 2015, une étude réalisée par le Groupe pour l’Enseignement en Matière de Population (GEEP), avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) révélait que 54,43% des filles tombées enceintes abandonnent leur scolarité.
La virginité comme bouclier dans un pays où l’avortement est interdit
Ses trois camarades ont un avis tranché sur la question, mais arborent aussi un regard compatissant sur la situation de Safia. Elles ne sont pas concernées et pour cause : elles sont toutes trois encore vierges.
« Je veux rester vierge jusqu’au mariage », m’explique Samia. Elle a un copain, certes, mais il est sur la même longueur d’onde qu’elle. Et puis, « c’est sa mère qui l’a dit », en s’appuyant sur un discours religieux.
Et le mariage, « pas avant que j’ai un travail ». Dès lors, avoir des enfants ne sera plus perçu comme une source de problème, au contraire puisque la fertilité est ici très valorisée.
Pour Anissa et Rania, c’est un peu différent. Je n’arrive pas bien à cerner la raison exacte de leur refus d’avoir des relations sexuelles au départ – en même temps elles ont 17 et 18 ans, c’est encore drôlement jeune pour aborder le sujet.
« Je ne veux pas, c’est tout. »
La contraception, inconnue au bataillon dans certains villages sénégalais ?
Je demande à Rania si un jour, si elle avait envie, elle franchirait le pas.
« Non je ne veux pas, car si j’ai un rapport sexuel avec un garçon, si j’ai un enfant, je vais être en tort. Si je tombe enceinte, ça va être très difficile. »
On tient une première raison. Du coup, j’enchaîne sur la contraception : est-ce qu’elle ne pourrait pas simplement se protéger ?
Je me heurte à un mur. Je repose ma question, sous plusieurs formes, plusieurs fois. La réponse est la même, « j’ai peur de tomber enceinte ». Je demande donc si on leur a expliqué à l’école comment ne pas tomber enceinte.
« On nous a dit si tu as couché avec un garçon juste à la fin de tes règles tu vas tomber enceinte. »
Je comprends qu’on leur a appris à compter leurs cycles, mais lorsque j’énumère les moyens de contraception, du préservatif au DIU en passant par la pilule et les injections : elle ne connaît pas.
À lire aussi : Tout savoir sur la contraception, quand tu débutes ta vie sexuelle
J’explique le fonctionnement de mon propre DIU, je tente d’illustrer ce qu’est un préservatif masculin, puis je repose ma question : s’il était possible d’utiliser l’un de ces moyens pour être 100% sûre de ne pas tomber enceinte, est-ce que tu le ferais ?
« Non, car si tu tombes enceinte parfois il y a des parents qui vont te taper. »
J’ai l’impression de donner des coups d’épée dans l’eau, en plus d’avoir le cœur brisé qu’elle ait peur d’être battue.
Avortement, contraception, éducation sexuelle : il faut réunir ces trois éléments pour des femmes libres
Je comprends qu’au delà de la question de l’avortement, qui a toujours été intrinsèquement liée à la contraception, il est question d’éducation sexuelle.
Les propos de Marie—Angélique Savané, qui se désespère de constater un recul en matière de droits des femmes et un « retour de bâton du conservatisme » me reviennent en mémoire :
« On avait à une époque mis en place tout un tas de programmes, il y avait des référents dans les lycées. Mais la majorité de ces derniers ont été délaissés, sans que je ne parvienne à m’expliquer pourquoi. »
Le Guttmacher Institute donne des statistiques sur la question de la contraception :
« La pratique contraceptive demeure faible au Sénégal. En 2014, 20% seulement des femmes mariées utilisaient une méthode de contraception moderne, en hausse par rapport à 16% en 2012 et 10% en 2005. De même, seules 25% des célibataires sénégalaises sexuellement actives pratiquent une méthode de contraception moderne. »
Je constate en rencontrant un groupe de femmes plus âgées, du même village, qu’après avoir eu des enfants, la planification familiale est beaucoup plus courante qu’au début de la vie sexuelle.
« C’est parce que si on utilise un contraceptif, on ne peut plus avoir d’enfants plus tard dans sa vie », m’explique-t-on.
Voilà une croyance de plus à déconstruire. Alors que l’on retourne vers le groupe avec Rania, je vois poindre un lueur d’espoir :
« Ce que tu m’as dit là, c’était très intéressant. »
Reste à lui apporter le reste, tout le reste, en terme d’éducation à la santé reproductive et sexuelle, pour qu’elle fasse ses choix en connaissance de cause.
Par / / madmoiZelle
*Les prénoms ont été modifiés
-
madmoiZelle au SénégalEsther est partie à la rencontre des Sénégalaises durant trois semaines. Elle y a réalisé interviews, portraits, reportages, qui s’égrainent au fil des jours sur madmoiZelle.
Pour retrouver le sommaire de tous les articles publiés et la genèse du projet, n’hésite pas à jeter un œil à l’article de présentation : madmoiZelle en reportage au Sénégal !
À lire aussi : Interdire l’IVG, c’est mettre la vie des femmes en danger, comme le confirme cette nouvelle étude



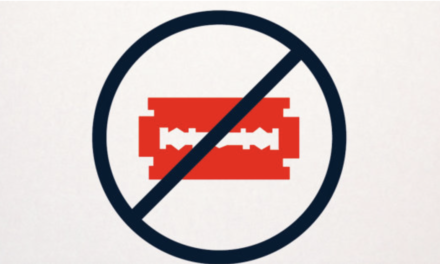



Il y a beaucoup d’idées reçues qu’on a surtout sur les sujet tabou dans certains pays. Finalement, sans être assez informées sur la contraception les jeunes femmes tombent enceinte plus souvent sans en vouloir…