Leur travail ne doit ni blesser, ni menacer, ni embêter personne… Contrairement aux hommes et bien malgré elles, les femmes se retrouvent souvent enfermées dans une posture professionnelle qui les bride. Dans son livre «Les Méritantes», la journaliste Lucile Quillet propose de briser ces chaînes de l’inégalité.
Les femmes sont les «bonnes élèves» qui travaillent beaucoup, veulent donner satisfaction, refusent rarement du travail en plus et veulent prouver qu’elles sont «la femme de la situation».

C’est parti d’une croyance naïve: j’ai cru qu’il ne dépendait que de nous. Que nous avions le choix. Qu’en apprenant à réseauter, négocier, faire son auto-promotion, on pouvait y arriver. Avoir la même carrière que les hommes, gravir les échelons, être bien payée, gagner en responsabilités et en pouvoir. Avoir un impact sur la société, être puissantes, décider. Tout était une question d’ambition et de volonté. Tant qu’il y a l’ambition, on peut se donner les moyens qui vont avec. J’ai cru que c’était une histoire d’empowerment, de confiance en soi.
J’ai écrit pendant des années sur le travail des femmes, j’ai fait d’innombrables interviews de coachs, d’experts de la mixité, de sociologues, j’ai écouté des femmes, cadres, employées, patronnes, me parler de leur vie professionnelle. Je suis moi-même devenue coach.
Je me considérais comme une invitée en sursis. Je travaillais beaucoup pour faire mes preuves, sans compter mes heures ni demander ce à quoi j’avais droit au comité d’entreprise. Bon petit soldat.
Je suis née en 1989, à la fin d’une décennie qui a normalisé les femmes en tailleur sortant de grandes tours, avec des porte-documents, ces fameuses working girls. J’ai grandi avec l’idée que je pouvais faire le métier qui me plaisait, que toutes les options étaient ouvertes. Ma mère avait fait des études scientifiques, elle était sa propre patronne. Mes parents m’encourageaient. Aucune école, aucun concours, aucun diplôme n’exclut les filles. L’école est mixte, les femmes travaillent, l’égalité est bien réelle. L’année de mon bac, je deviens majeure, Nicolas Sarkozy est élu président et nomme pléthore de femmes ministres. J’ai le choix. Ces années-là, Angela Merkel ou Christine Lagarde deviennent des femmes puissantes. Sheryl Sandberg nous dit que l’on peut tout avoir. On crée le Women’s Forum. On célèbre les Mercedes Erra, Anne Lauvergeon, Isabelle Kocher. Laurence Parisot est à la tête du Medef. Il y a des icônes, des «rôles modèles». Tout va bien.
Quelques années après, je fais mon entrée en entreprise. Nous sommes toute une génération de nouveaux et nouvelles. Je nous vois, les filles, besogneuses, volontaires, pleines d’initiatives, à accepter de faire plus que notre travail pour prouver que nous en voulons, à vouloir démontrer qu’il serait un bon calcul de nous embaucher sur le long terme. Nous faisons nos preuves. Les garçons de ma génération, eux, font comme chez eux. Ils font ce qu’on leur dit, ni trop ni moins. Ils s’en tiennent à leurs tâches mais parviennent à rayonner au-delà de leur bureau. Je les vois devenir plus connus et reconnus. Ils se baladent dans les couloirs avec aisance, appellent nos aînés par leur prénom, s’habillent comme eux même s’ils ont vingt ans de moins, ils traînent à la machine à café, appellent l’entreprise la «maison». Ils sont chez eux.
Le travail des femmes n’est pas une niche, mais un carrefour d’observation de notre époque: à travers lui, on touche au monde professionnel, à la vie privée et à la place des femmes dans la société.
Je voulais écrire sur le travail des femmes, sujet que je trouvais très absent dans la presse féminine avec laquelle j’ai grandi et que j’aimais. Parmi les pages «Vie pratique» de fin de magazines destinées à améliorer le quotidien (sport, nutrition, enfants, voyages, déco, etc.), le travail n’existait pas ou peu. De temps en temps, un article sur les inégalités de salaires pour dresser un constat désolant. Parfois, on lisait des choses sur le harcèlement sexuel (c’était avant #MeToo). Mais le travail qui nous occupait plusieurs jours par semaine, le travail par lequel nous pouvions devenir les vraies égales des hommes était une sorte de non-sujet, ou alors très occasionnel. On disait aux femmes «Soyez audacieuses! Osez!», puis c’est tout.
Je voulais creuser la question: il devait bien y avoir autre chose à dire. Et puis, c’était quoi au juste, «oser»? De quoi parlait-on? Quelles étaient les règles du jeu? Je voulais apporter des conseils concrets, éclairer le chemin. J’ai abordé le sujet par le prisme de l’empowerment. Pourquoi n’avions pas les mêmes carrières, postes et salaires que les hommes, alors que nous avions les mêmes options? Qu’est-ce qui bloquait? Et comment le débloquer, évidemment? J’ai proposé une chronique pour donner des conseils, interroger des coachs et experts de la mixité. Apprendre à «péter le plafond de verre» et «décoller comme une fusée». Ma rédactrice en chef me donne le feu vert. «On verra bien si on fait le tour après une dizaine d’articles.»
Plusieurs années durant, j’ai écrit sur le travail des femmes. Beaucoup d’articles de coaching donc, mais aussi des articles de témoignages et d’analyse. J’ai tiré un fil qui ne s’arrêtait pas. Le travail des femmes n’était pas une niche, mais un carrefour d’observation de notre époque: à travers lui, on touche au monde professionnel, à la vie privée et à la place des femmes dans la société.
Impostrices, bonnes élèves et bons petits soldats
Je n’ai pas compté le nombre de femmes qui m’ont parlé de leur vie professionnelle ces dix dernières années. Elles étaient indépendantes, cheffes, patronnes, employées, à temps partiel ou temps plus que plein. Toujours, des dénominateurs communs quels que soient les métiers, les grades ou les secteurs professionnels. Je les ai entendues dire qu’elles se sentaient souvent illégitimes et impostrices.
Les femmes ont appris à vivre dans le doute permanent, avec cette petite voix par-dessus leur épaule qui leur murmure qu’elles sont trop cela, ou pas assez ceci, qu’elles ne devraient pas faire ou dire cela… Cette petite voix ne reste pas gentiment au seuil de leur travail. Passé le tourniquet d’entrée, les questions affluent tout aussi abondamment: méritons-nous vraiment notre place? Ne l’avons-nous pas prise à quelqu’un d’autre? Sommes-nous bien les plus aptes? Allons-nous y arriver?
Je les ai entendues trouver «normal» de bien travailler et anormal de le faire savoir. Prétentieux. Je les ai entendues se contenter d’un salaire convenable mais pas fou, d’un travail pratique avec leur vie de famille. S’asseoir sur la reconnaissance, faire plus avec moins. Je les ai entendues, dans ce monde qui sous-estime leur valeur, minimiser elles-mêmes leur mérite.
Souvent, elles sont gênées quand on leur fait des compliments. Elles les relativisent avec des phrases qui commencent par «non mais» et poursuivent en détaillant les facteurs extérieurs de leur succès: «J’ai eu de la chance», «Je n’ai fait que mon travail», «C’était un travail d’équipe avant tout», «Je ne serai pas là sans Michel», «Je n’y serai pas arrivée sans le soutien de mon mari/mes parents/mon boss», «Le hasard a bien fait les choses». Elles recontextualisent pour braquer la lumière ailleurs. Trop humbles, trop modestes, trop polies, les impostrices.
Nous pensons que la barre est trop haute, qu’il nous manque des compétences. Nous craignons l’échec comme un chat craint l’eau. C’est un mélange d’orgueil et de manque de confiance en soi.
Le spectre de la honte plane régulièrement au-dessus d’elles: si elles faisaient une erreur, si elles avaient tort, si elles postulaient et se plantaient, cet échec serait comme une tache indélébile, la preuve qu’elles ont cru savoir, mériter plus et être assez. Pour qui se sont-elles prises? Celles qui n’attendent pas la validation des autres supportent leur jugement. Si l’on se met sous la lumière, si l’on prend des initiatives, on doit être béton, prendre les balles et pouvoir défendre, justifier, assurer et assumer tout ce qu’on avance sans faillir. Sinon, on se rassoit et on évite de faire la maligne.
Nous avons peur de perdre: perdre la face, des opportunités ou notre crédibilité avec de mauvais choix, comme si l’on pouvait être assez intelligent pour voir clair à l’avance. Comme si le travail n’était pas un terrain où l’on testait et apprenait, mais où l’on devait démontrer qui l’on est et avoir toujours raison.
En nous, il y a comme un petit tribunal intérieur qui nous envoie constamment des avertissements. Nous sommes devenues nos propres juges, impitoyables et intransigeantes. Cette petite voix du perfectionnisme, de l’exemplarité, de l’irréprochabilité nous intimide, nous dissuade. Nous pensons que la barre est trop haute, qu’il nous manque des compétences. Nous craignons l’échec comme un chat craint l’eau. C’est un mélange d’orgueil et de manque de confiance en soi.
Pendant ce temps, les autres avancent. J’ai beaucoup entendu les femmes parler de ce collègue qu’elles détestent et qui cristallise toute leur incompréhension. C’est celui qui en fait deux fois moins mais obtient deux fois plus, qui s’approprie leur travail tout en les dénigrant, qui ne se justifie jamais mais exige toujours plus. Celui que tout le monde trouve «super» alors qu’il n’a rien d’incroyable. Plus c’est simple pour lui, plus c’est frustrant pour elles. Je les ai entendues aussi hésiter à cause de leur vie personnelle. Déchirées entre leurs ambitions et l’agenda familial, jongler entre mille corvées et questions. Mettant souvent dans la balance le bien-être et la qualité de vie de leurs enfants face à leur temps et leurs responsabilités professionnelles –ce que font rarement leurs conjoints.
Je les ai vues tenter de jouer à Wonder Woman, faire la démonstration de leur agilité et de leur capacité à «performer», pour «cocher des cases» et conforter le mythe rassurant que les femmes peuvent tout avoir. Je les ai entendues taire leur fatigue à la maison, jongler comme au cirque et se dire qu’avec une bonne to do list, tout ira mieux. Je les ai vues se taire au travail pour ne pas valider le stéréotype selon lequel «une femme, c’est toujours plus compliqué». Dans cette course effrénée, la culpabilité est une partenaire de choix, même quand elles y arrivent. Car je les ai aussi entendues gênées de réussir vis-à-vis de leur conjoint.
Leur travail ne doit visiblement ni blesser, ni menacer, ni embêter personne. Pour cela, elles ont pris l’habitude de prendre sur elles et de réfléchir pour deux. Alors, elles se demandent comment réagir face à ce collègue sexiste, à celui qui leur coupe la parole, mais surtout sans vexer personne ni passer pour une harpie. Elles se demandent quand est le «bon moment» pour faire un enfant, tout comme elles annoncent un peu désolées leur grossesse à leur employeur.
Cette éducation de petites filles sages nous met du plomb dans l’aile. Être sage nous valorise à l’école et nous ralentit au travail. Les règles ont changé, la méritocratie n’est plus au rendez-vous.
Nous avons tellement appris à nous responsabiliser à la place des autres et à anticiper les problèmes que nous nous tirons nous-mêmes des balles dans le pied en silence. C’est ce que j’appelle le syndrome de la boule de cristal. Cette capacité à faire les réponses avant même de poser la question. «Non, mon conjoint ne voudra pas me suivre dans une autre ville, alors je n’en parle même pas.» «Non, cette reconversion serait trop compliquée avec ma vie de famille, donc j’oublie.» «Non, ils ne vont pas me donner d’augmentation, alors je ne demande pas plus.» «Non, il doit déjà y avoir un favori, alors je ne postule pas.» On se creuse la tête et les autres n’ont pas besoin d’utiliser la leur.
Et puis, il y a le syndrome de la Miss (celui-là aussi est de moi), à savoir ce besoin que nous avons d’être aimées, appréciées par nos collègues et notre employeur. Être élue dans le cœur d’autrui, populaire. Une fille sympa. Notre éducation nous a appris que notre valeur dépendait du regard des autres, qu’une vie réussie était une vie où l’on obtenait l’amour d’autrui: famille, mari, enfants, etc. Pourquoi en serait-il autrement au travail?
La collègue sympa est agréable, partage des éléments de sa vie privée comme gage de confiance (même si ça peut lui revenir en boomerang dans la figure), ne dit pas non pour rendre service, fait le café, les cadeaux de départ, prend les notes, écoute les âmes tourmentées à la machine à café. Beaucoup de femmes n’attendent pas qu’on respecte d’office leur légitimité: elles passent un peu tous les jours en entretien d’embauche auprès de leurs collègues, pensant qu’elles doivent se montrer dignes d’être intégrées pour avoir une vraie place.
La Miss ne fait pas trop de vagues, y compris avec son chef. Elle ne revendique pas grand-chose, dit toujours oui quand il faut donner un coup de collier. Elle ne veut pas demander plus, car elle refuse que son patron puisse penser qu’elle travaille «pour l’argent». Nous croyons qu’en ne jouant pas aux difficiles, nous obtiendrons les bonnes grâces de nos supérieurs. C’est pratique. Après tout, quand on aime vraiment son métier, quand on a la chance de travailler, on ne parle pas d’argent. Et oui, au travail aussi, quand on aime, on ne compte pas.
De façon générale, il ne faut pas être pénible, ni vindicative. Cette éducation de petites filles sages nous met du plomb dans l’aile. «Travaille bien, fais un bisou et dis merci», ça ne marche pas dans le monde professionnel. Être sage nous valorise à l’école et nous ralentit au travail. Les règles ont changé, la méritocratie n’est plus au rendez-vous. Les femmes doivent reconfigurer leur logiciel pour passer les niveaux supérieurs. Alors elles se forment et apprennent les codes en faisant du coaching.
SOURCE : https://www.slate.fr/economie/bonnes-feuilles-les-meritantes-lucile-quillet-liens-qui-liberent-quand-merite-suffit-pas-monde-travail-trahit-femmes-inegalites?utm_campaign=la-quotidienne&utm_medium=email&utm_edition=202510160400&utm_source=newsletter




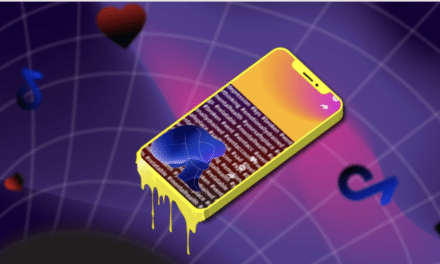



Commentaires récents