« Bitch, better have my money, pay me what you owe me ! » (« Salope, tu ferais bien de me donner mon argent, paye-moi ce que tu me dois ! ») devrait être le slogan de toutes les femmes. Rihanna, dont il se dit qu’elle s’adressait à la comptable qui l’avait escroquée, résume dans cette chanson l’énergie qui devrait nous animer lorsqu’il s’agit de réclamer notre dû. On le sait, les femmes ont des revenus bien inférieurs à ceux des hommes. Mais l’injustice ne se cantonne pas au travail salarié. Si les clichés sexistes dépeignent volontiers les femmes vénales, la réalité est pour elle une arnaque permanente. C’est Christine Delphy qui a théorisé l’« exploitation domestique » pour décrire les services fournis gratuitement par les femmes en couple hétérosexuel. Le travail domestique, c’est le labeur quotidien nécessaire au bon fonctionnement du foyer, qu’il s’agisse d’entretien, de préparation des repas, de prise en charge des enfants dans leurs activités les plus diverses et d’approvisionnement. Un travail assumé en moyenne à 70 % par les femmes dans les ménages hétérosexuels, sans contrepartie. Si bien que deux tiers du temps travaillé par les hommes sont rémunérés, alors que les femmes consacrent deux tiers de leur temps à une activité non rétribuée. C’est sur ce travail gratuit et socialement invisible que repose en partie l’exploitation des femmes (qui comprend également une dimension sexuelle et reproductive). Christine Delphy parle de « services sexuels et affectifs », sachant qu’à cette époque la problématique du viol conjugal n’était pas autant identifiée. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un service mais d’une forme de violence installée dans le couple. Le travail émotionnel qui assure la stabilité des relations du foyer et la gestion des crises est également imputé aux femmes. Dans une perspective marxiste, ces féministes considèrent ainsi que les hommes s’approprient le travail des femmes qui, selon des études de l’INSEE, représenterait en France 33 % du PIB ! Le travail de la journaliste Titiou Lecoq montre également à quel point, dans les couples hétérosexuels, les conjoints qui présentent les revenus les moins élevés (les femmes, dans la plupart des cas) sont pénalisés en cas de séparation15. En effet, les hommes participent aux dépenses les plus conséquentes et plus faciles à documenter (immobilier, véhicules…), tandis que les femmes procèdent davantage aux achats du quotidien. Si bien que, quand sonne le glas du couple, qui est en mesure de produire des factures et repartir tranquillement avec « ses » biens ? C’est monsieur. Évidemment. Le nombre de pensions alimentaires non versées par les hommes à l’issue des séparations témoigne des violences économiques qui perdurent au-delà de la vie du couple. Violences renforcées par des institutions qui permettent aux personnes qui versent ces pensions – des hommes, dans l’immense majorité – de bénéficier d’une niche fiscale quand les récipiendaires voient ces sommes destinées à leurs enfants figurer aux rangs de leurs revenus. Ainsi le couple est le lieu de l’expropriation des femmes : leur travail rapporte à la société, mais celle-ci ne prend pas la responsabilité de les rétribuer. Cette charge devrait pourtant être partagée collectivement. La chanteuse Mariah Carey a bien compris le coût réel de la vie de couple, et elle en a tiré des conclusions concrètes. J’adore raconter la manière dont elle a littéralement fait payer son ex de sa désinvolture. Lorsque son fiancé a mis fin à leur union, celle-ci l’a attaqué en justice réclamant une compensation financière de 50 millions de dollars du fait d’une « indemnité pour le dérangement » (inconvenience fee). Elle estimait qu’il lui avait fait perdre son temps, et l’avait contrainte à réorganiser sa vie et celle de ses enfants du fait de leur projet de mariage. Et elle a gagné son procès ! L’argent, quand on est militant·e en faveur des droits humains, est un vrai casse-tête. Autour de moi, nombre de mes amies, féministes notamment, engagées dans la vie publique ont honte de réclamer une rémunération lorsqu’elles sont sollicitées. Souvent, elles se contentent d’une prise en charge minimale. Les travaux des femmes sont si rarement reconnus que leur simple exposition peut faire oublier la contrepartie qu’ils mériteraient. On ne peut pas louer le travail de quelqu’un sans permettre à cette personne de poursuivre ce travail dans de bonnes conditions. Dès lors que c’est possible, la pérennité de leur travail doit être reconnue de manière concrète par une contrepartie financière. Pourquoi ne pas appliquer ce principe à toutes les collaborations ? Connaître sa valeur et la clamer haut et fort est fondamental pour être en mesure d’occuper l’espace que l’on mérite. Et le mérite n’est pas qu’une valeur abstraite. C’est pourquoi il est indispensable de faire reconnaître économiquement la valeur de son travail. .
SOURCE : Diallo, Rokhaya. Dictionnaire amoureux du féminisme (pp. 35-38).



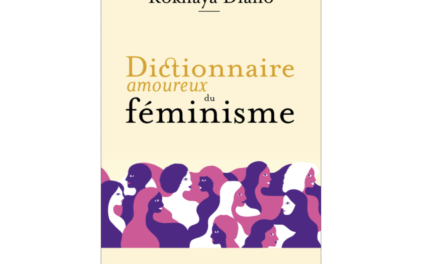

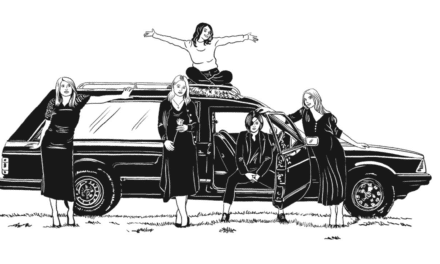

Commentaires récents