Asexualité
Dans l’acronyme LGBTQIA+, le A fait l’objet d’une attention relativement modeste, comme le petit dernier d’une grande fratrie. Et pourtant son importance est équivalente à celle de toutes les orientations sexuelles. Les asxuel·les, ou « aces », pour les intimes, sont les personnes qui ne ressentent pas ou peu de désir sexuel. Cela ne signifie pas l’absence de libido – « l’onanisme peut très bien faire partie de leurs pratiques », comme l’explique dans Télérama Anthony Bogaert18, un chercheur canadien qui, selon le magazine, figure parmi les premiers, et rares, à avoir étudié cette orientation dans les années 2000.
L’asexualité est bien plus répandue que ce que sa représentation publique ne semble l’indiquer, pourtant elle est encore invisible médiatiquement et socialement. Le terme me paraît imparfait, dans la mesure où le « a » privatif laisse entendre l’idée d’un manque, mais il a le mérite de mettre un nom sur une pratique en manque de visibilité. Les aces sont multiples, et leur rapport à l’amour et au sexe n’est pas uniforme. L’asexualité peut être associée à l’aromantisme qui désigne celles et ceux qui ne ressentent pas d’attirance romantique vis-à-vis d’autres personnes, quels que soient leur genre ou orientation sexuelle, mais cela n’a rien d’automatique. On peut éprouver des sentiments amoureux sans qu’y soit associé un désir sexuel.
Notre culture présente la sexualité comme l’aboutissement logique de toute relation romantique (que l’on dit d’ailleurs « consommée »), sans quoi c’est la nature même des sentiments qui est questionnée. D’ailleurs, on parle de « faire l’amour », comme si le sexe était la manière la plus aboutie de témoigner du sentiment amoureux. Étrangement, on admet sans difficulté l’idée que le sexe puisse être pratiqué indépendamment de toute affection romantique, mais il semble impossible d’imaginer que l’amour romantique puisse être réel s’il n’est pas matérialisé par la sexualité. D’ailleurs, la France figure parmi les pays où l’on peut invoquer une faute justifiant un divorce si un des partenaires ne souhaite pas avoir de relations sexuelles.
La justice elle-même ne conçoit pas qu’une union matrimoniale puisse ne pas être assortie d’une vie sexuelle. Dans la construction d’une vie moderne, la relation sexuelle tient souvent du rite de passage. La pratique du sexe confère aussi une valeur sociale (surtout aux hommes, il faut bien le reconnaître), et son absence dévalorise socialement. La longue histoire de la répression de la sexualité et du contrôle des interactions sexuelles explique en grande partie cette survalorisation. Après des siècles de silence et de tabou, la sexualité a accédé à une visibilité conséquente dans nos sociétés. De la position honteuse et répréhensible, le sexe a été promu au rang de l’activité indispensable. De pratique cachée, éloignée des regards, elle est devenue un impératif sociétal, s’affichant triomphalement sur les murs et dans les créations artistiques. J’ai été socialisée dans un contexte culturel qui m’a convaincue de la nécessité absolue de mener une vie sexuelle accomplie. Durant les années 1980 où j’ai grandi, le sexe était exposé sur des panneaux publicitaires (la nudité des femmes pour être plus précise, ce qui pose d’autres questions quant à l’instrumentalisation de leurs corps), les films donnaient la part belle à la sexualité de leurs personnages, et les discours étaient orientés vers la quête d’une sexualité heureuse et libre. Je me souviens du personnage de Donna de la série Beverly Hills 90210. Son choix de l’abstinence sexuelle la plaçait telle une anomalie dans l’univers des séries ados états-uniennes où la sexualité était presque un personnage à part entière. Spoiler alert : après sept saisons d’abstinence, Donna a fini par coucher avec David, son amoureux de toujours. Ça ne pouvait pas durer éternellement non plus !
Dans la culture populaire, le sexe m’a toujours été présenté comme une mesure obligatoire, presque hygiénique, dont tout être humain aurait besoin sous peine d’une « misère » qui affecterait nécessairement sa santé physique et mentale. Le désir sensuel, le plaisir sexuel sont perçus comme l’alpha et l’oméga de l’épanouissement dont aucun individu « normalement » constitué ne saurait s’affranchir. Toute personne aspirant au bonheur devrait ainsi considérer l’activité sexuelle comme l’horizon désirable absolu. Cette injonction spécifique aux sociétés dites occidentales a surgi telle la réparation des interdits propres à la France antérieure à Mai 68. Après la nécessaire et courageuse provocation destinée à pourfendre les tabous culturels qui condamnaient la pratique sexuelle hors mariage à la clandestinité, et au moins à la discrétion lorsqu’elle avait cours dans le cadre d’une relation matrimoniale, c’est désormais l’hypersexualisation qui règne. Si les années sida et la crainte de la propagation de l’infection ont établi de nouvelles habitudes et pratiques de prudence, le sexe a toujours été présenté comme un passage obligatoire. Le plaisir sexuel est sacralisé, élevé au rang de la joie la plus absolue que l’on pourrait ressentir, et la voie la plus certaine vers l’épanouissement psychologique et même moral. Dans notre contexte culturel français, ne pas accéder au sexe vous dévalue socialement. Aussi, toute personne adulte doit être disposée à la sexualité sous peine d’être stigmatisée. Les personnes dont la sexualité est active sont perçues comme de bon·nes vivant·es, joyeuses, croquant la vie à pleines dents, tandis que les abstinent·es sont perçues comme des rabat-joie, l’absence de sexe comme une anomalie sociale que l’on associe à une forme de disette et de tristesse. L’abstinence est un tabou, classée au rang des anomalies sociales et autres défaillances honteuses. C’est aussi une conception validiste du sexe, car de nombreuses personnes handicapées sont exclues de l’accès à une sexualité du fait de l’oppression subie puisqu’elles vivent dans une société qui ne sait reconnaître leur sexualité comme digne. Dans son article « Towards a Historical Materialist Concept of Asexuality and Compulsory Sexuality » (2018), le chercheur canadien (lui aussi, à croire qu’un air spécial nourrit les cerveaux au Canada) Carter Vance démontre que la sexualité conçue comme une obligation sociale a été construite, et qu’elle a pour conséquence la pathologisation de l’absence de sexualité. Si vous n’avez pas de vie sexuelle (l’expression laisse songeuse…), c’est que vous avez un problème. Et si vous avez un problème, on peut vous soigner. Le capitalisme a toujours un remède pour vous. L’universitaire explique ainsi que cette classification de l’absence de sexualité comme un dysfonctionnement donne lieu à la création d’un marché qui propose à la fois des produits (médicaments, sex-toys…) et des services (conseils, coaching, applis de rencontres…) prétendant aider à accéder au graal. Le discours dominant laisse entendre que tout le monde veut du sexe et y associe des discours culpabilisants associés à des pressions psychologiques émises tout au long de nos existences sociales. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui n’ont pas d’activité sexuelle pour des raisons diverses. Si l’on songe spontanément à une abstinence contrainte faute d’opportunités, ou si l’on imagine un refus lié à des convictions spirituelles, il est plus rare que l’on évoque tout simplement l’absence de désir de s’engager dans des interactions sexuelles.
Cette conception archaïque est le résultat d’un mensonge collectif qui présente l’activité sexuelle comme un besoin vital, le sexe figurant comme une donnée cardinale de l’équilibre physique et mental. Des légendes urbaines telles que celle des « couilles bleues » (selon laquelle les hommes qui ne pratiquent pas le sexe finissent par voir leurs testicules bleuir de désespoir…) y ont largement contribué. Pourtant l’asexualité existe bel et bien. Et la présentation de la sexualité active comme corollaire de l’épanouissement individuel et amoureux ne laisse guère de place à l’idée d’une vie sans sexe choisie et heureuse. Les personnes qui n’ont pas de relations sexuelles sont rarement considérées comme exprimant un désintérêt réel pour le sexe. Le fait de ne pas connaître le plaisir sexuel de manière régulière est perçu comme une lacune qui conduit nécessairement au manque et à une mauvaise santé. Si le sujet est soigneusement évité par la sphère publique, c’est parce qu’il reste lié à l’échec et à la honte sociale. En effet, le jugement social est souvent sans appel et mâtiné de misérabilisme. Nommer l’asexualité, sans la confiner au rang de l’abstinence qui peut donner l’impression d’un renoncement, c’est légitimer un choix valide, parmi toutes les orientations sexuelles existantes. Le droit de ne pas avoir envie.
Voir : LGBTQIA+.
SOURCE : Diallo, Rokhaya. Dictionnaire amoureux du féminisme (pp. 42-46).


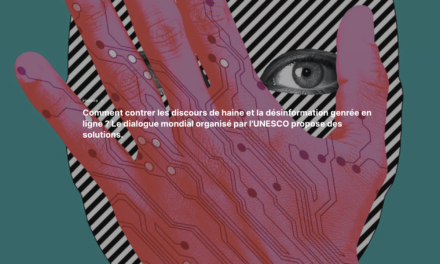

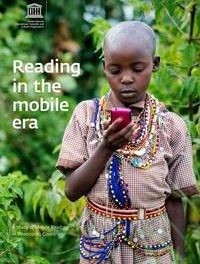
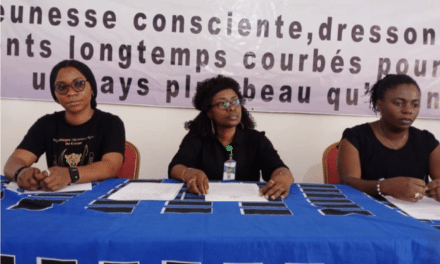

Commentaires récents