Alors que les Africaines demeurent soumises à de nombreux abus, des acteurs communautaires, des femmes influentes et de jeunes militantes montent au front. Une série d’articles du quotidien Le Monde : « En Afrique, les femmes face aux violences » (1/4).
Etre une femme en Afrique, c’est, plus qu’ailleurs, subir une existence jalonnée de violences. « L’Afrique est la région du monde où les femmes ont le plus de risques d’être tuées par un partenaire intime ou un membre de la famille », révèle une étude de l’ONU Femmes publiée en 2019. Parmi les pays les plus dangereux pour elles figure l’Afrique du Sud : chaque heure, en moyenne, trois femmes y meurent sous les coups de leur conjoint.
Les féminicides, fléau mondial, fauchent en premier lieu les femmes de la famille, les travailleuses du sexe mais aussi des femmes âgées recluses ou des fillettes orphelines accusées de sorcellerie dans des pays ravagés par la guerre, comme en République démocratique du Congo (RDC). Un acte d’anéantissement qui s’inscrit souvent dans un continuum de brutalités physiques, sexuelles, psychologiques et économiques.
Qualifiées par l’ONU de « violation des droits humains la plus répandue mais la moins visible au monde », les violences basées sur le genre affectent massivement les Africaines. En 2018, une enquête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) révélait que 65 % des femmes en Afrique centrale et 40 % en Afrique de l’Ouest ont subi des violences. Des chiffres en deçà de la réalité, précisent les associations de défense des droits des femmes. En effet, la peur de la stigmatisation décourage trop souvent les victimes de dénoncer leur agresseur. Au Niger, 99 % des victimes de viols ne saisissent pas la justice, selon une étude de la fondation allemande Friedrich-Ebert. Et quand elles le font, les condamnations ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits.
Mariages forcés, violences conjugales…
Pourtant, la lutte contre les violences basées sur le genre s’est peu à peu inscrite dans les agendas politiques des Etats africains ces dernières années. Numéros verts, ministère de la femme, programmes d’autonomisation financière… Autant de gages donnés par les pays africains aux bailleurs de fonds internationaux comme preuves de leur engagement envers les droits des femmes.
Reste que ces politiques du genre peinent à produire des résultats efficaces. « Toutes ces campagnes [sur le genre] ne remettent pas en cause les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent les relations hommes-femmes », déclarait en janvier au Monde la sociologue Fatou Sow. L’universitaire pointait l’effet pervers des petits prêts financiers accordés aux femmes par les Etats et les ONG pour réduire les inégalités de genre :
« Plutôt que d’octroyer des microcrédits aux femmes, il faudrait leur permettre d’accéder à tous les secteurs d’activité, y compris ceux préemptés par les hommes, en les formant, en les équipant et en les finançant correctement. Au risque sinon de contribuer à entretenir leur relégation sociale. »
La domination masculine se mesure également à l’aune de l’indice d’inégalité de genre (IIG) établi par l’ONU et qui place nombre d’Etats subsahariens en queue de peloton. Sur 162 pays, le Sénégal se classe au 130e rang, le Burkina Faso au 147e, le Mali au 158e. Ces données qui datent de 2019 n’intègrent pas les reculs enregistrés suite à la crise sanitaire liée au Covid-19.
L’Afrique subsaharienne affiche le taux de mortalité de femmes en couches le plus élevé au monde
Derrière ces chiffres se cachent des violences protéiformes qui parfois se cumulent, surtout pour les femmes les plus démunies. Il s’agit des mariages précoces ou forcés, des violences conjugales et sexuelles, de la confiscation des ressources économiques. Mais le pic du danger est atteint au moment de donner la vie. Car même si des progrès notables en matière de santé maternelle ont été réalisés ces dernières années, l’Afrique subsaharienne affiche toujours le taux de mortalité de femmes en couches le plus élevé au monde, notamment chez les adolescentes.
En Guinée, 97 % des femmes sont excisées
A ce sinistre tableau s’ajoute la persistance des mutilations génitales féminines, pratiquées dans des proportions effroyables. En Guinée, 97 % des filles et femmes ont été excisées, et près de 90 % dans les régions du centre-est du Burkina Faso. Au Sénégal, un quart des plus de 15 ans ont été excisées. Au Mali, l’un des trois pays africains à n’avoir pas criminalisé l’excision (avec la Sierra Leone et le Liberia), la proportion monte à 73 % chez les filles âgées de moins de 14 ans et à 89 % chez les 15-49 ans.
Pourtant, la pratique est interdite dans une cinquantaine de pays. Mais les Etats africains signataires de traités internationaux garantissant la lutte contre ces violences peinent à faire appliquer leurs engagements, et ce malgré l’adoption de lois plus sévères ces dernières années. Les autorités politiques sont en réalité entravées par le droit coutumier, souvent prééminent sur le droit moderne, notamment en zone rurale. Une supériorité qui favorise une culture de l’impunité, comme en Guinée, où les arrangements à l’amiable entravent la judiciarisation des affaires de violences sexuelles.
C’est face à ce constat d’inefficacité des institutions qu’ont émergé de nouveaux acteurs engagés pour changer les mentalités et protéger la vie des femmes. Là où les campagnes publiques de sensibilisation échouent à convaincre des époux ou des hommes de bannir la violence contre elles, chefs religieux, autorités traditionnelles et femmes influentes apparaissent comme des intermédiaires plus légitimes que les ONG, celles-ci étant souvent perçues comme éloignées des réalités des populations.
Ce sont ainsi les « fiosron », au Togo, qui parlent à l’oreille de leurs chefs de mari pour qu’ils sermonnent un époux maltraitant. Au Tchad, où 60 % des filles sont mariées avant 18 ans, les « super banat » (« filles », en arabe), de jeunes militantes féministes, jouent les médiatrices auprès des familles.
Au Sénégal, des imams s’impliquent
Au Sénégal, pays où les féminicides défraient régulièrement la chronique, quelques imams s’impliquent également. Lors du prêche du vendredi, ils enjoignent les maris à ne pas violenter leurs épouses. Aussi, depuis 1995, le Réseau Islam et Population réunit des savants musulmans. Ils parcourent le pays armés d’argumentaires religieux pour convaincre par exemple les maris de l’importance d’espacer les grossesses pour protéger la vie des mères et du caractère licite de la contraception.
Un travail qui rencontre néanmoins de fortes résistances dans un pays en proie à une poussée ultraconservatrice ces dernières années. « La plupart des religieux compliquent notre action de sensibilisation contre le mariage des enfants ou l’excision. Ils nous accusent d’être des toubabs et de vouloir détruire nos traditions. Or ce sont eux que les populations écoutent », déplore Fatimata Sy, présidente de l’Association sénégalaise pour l’avenir de la femme et de l’enfant, qui intervient dans le nord du Sénégal.
« Nos grand-mères nous rétorquent qu’elles ont été excisées et que c’est une bonne pratique », regrette Fatimata Sy
L’instrumentalisation politique du concept de « genre » entrave également l’action des médiateurs. « Nous n’employons plus ce mot dans nos campagnes et ateliers, car les religieux l’associent à la promotion de l’homosexualité. Nous parlons de “lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles”, sinon les gens ne nous écoutent pas ou peuvent être agressifs », explique Fatimata Sy. Preuve de cette pression, le ministère sénégalais de la femme a été rebaptisé en septembre lors de la nomination du nouveau gouvernement. Disparue la mention de « genre » dans son intitulé, le ministère est désormais chargé « de la femme, de la famille et de la protection de l’enfance ».
Par ailleurs, ces intermédiaires rencontrent une autre limite majeure : celle de certaines aînées, dont le soutien est souvent indispensable pour faire cesser certaines pratiques. Sur l’excision par exemple, comme le constate Fatimata Sy :
« Nos grand-mères continuent de nous rétorquer qu’elles ont été excisées et que c’est une bonne pratique. Ces convictions sont un frein à la lutte, car ce sont elles, souvent, qui font mutiler leurs filles et petites-filles. »
Intériorisation des stéréotypes sexistes
Il leur faut aussi lutter contre l’intériorisation des stéréotypes sexistes par les femmes elles-mêmes. Ainsi au Niger, 60 % des femmes interrogées dans une étude du ministère de la population affirment qu’« un homme a le droit de battre son épouse quand elle refuse d’avoir des rapports sexuels avec lui ou qu’elle polémique avec lui ». Selon la même étude, « plus de trois femmes sur dix (35 %) justifient ce comportement quand la femme brûle la nourriture ».
A l’heure où les voix des féministes du continent rencontrent de plus en plus d’écho, le soutien aux intermédiaires communautaires et à la scolarisation de masse des filles apparaît cruciale pour endiguer l’épidémie silencieuse des violences basées sur le genre. « La vie des Africaines compte si peu. Cela doit cesser », somme Fatimata Sy.
Dossier réalisé en partenariat avec le Fonds français Muskoka.
Pour ne rien manquer de l’actualité africaine, inscrivez-vous à la newsletter du « Monde Afrique » depuis ce lien. Chaque samedi à 6 heures, retrouvez une semaine d’actualité et de débats traitée par la rédaction du « Monde Afrique ».




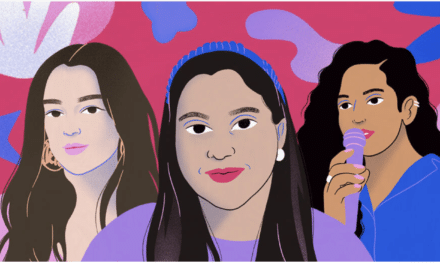


Commentaires récents