Dans son dernier livre paru en français, Sur les fonts de la paix : Guide de l’activiste pour un monde nouveau, Séverine Autesserre examine « l’industrie de la paix » – les Nations Unies, les organisations non gouvernementales, les ambassades, etc. – et montre, en s’appuyant sur des cas du monde entier, notamment le cas de l’île d’Idjwi, que la paix peut se développer dans les circonstances les plus improbables, à une simple condition : une paix durable exige de donner le pouvoir aux citoyens locaux. Parfois soutenues par des étrangers, leurs initiatives novatrices montrent qu’un changement d’approche radical est à opérer si nous voulons construire une paix durable autour de nous, notamment au Congo ou ailleurs. Debout Congolaises publie ci-dessous quelques bonnes feuilles tirées du chapitre 1 : Idjwi, l’île de la paix.
En 2015, un chef de milice nommé Chance Pay Rusiniku a tenté de créer un énième groupe d’insurgés au Congo. Il voulait installer sa base à Idjwi, une île au milieu du lac Kivu, près de la frontière du Rwanda, et son mouvement devait ressembler à tous ceux qui mettaient d’autres régions du pays à feu et à sang. Toutefois, à Idjwi, les choses ne sont pas passées comme ailleurs. À l’exception d’une poignée d’entre eux, les paysans ont refusé de suivre le rebelle ; ils étaient effrayés à l’idée de voir la violence s’installer sur leur île. Chance a tenté de les convaincre de force. Il a assassiné trois chefs locaux et menacé du même sort les gens du voisinage s’ils ne lui donnaient pas d’argent ou de soutien. En vain. Cette stratégie de la terreur s’est même retournée contre lui : ses crimes lui ont valu l’inimitié de tous, des citoyens ordinaires mais aussi des élites locales et des représentants de l’État. Traqué par l’armée congolaise, et ne trouvant aucun allié à Idjwi, Chance s’est enfui vers la ville voisine de Goma, sur le continent, où il a fini par être arrêté.
Idjwi a toujours été renommée au Congo pour ses délicieux ananas. Mais aujourd’hui, l’île mérite d’être connue pour une autre denrée, bien plus précieuse : la capacité de ses 320 000 habitants à créer un sanctuaire de paix dans un conflit qui a fait cinq millions de morts.
Les journalistes et les fonctionnaires des Nations unies surnomment souvent le Congo le « pays du viol ». Les reportages se concentrent sur la guerre et la violence et le présentent comme un chaos permanent. Politiques et chercheurs clament que le conflit est insoluble : même l’une des plus grandes missions de maintien de la paix des Nations unies jamais déployée, dotée d’un budget annuel d’un milliard de dollars et de 18 000 soldats, n’a pas réussi à endiguer l’effusion de sang.
 Je me rends régulièrement au Congo depuis 2001. J’en ai parcouru toutes les provinces les plus violentes et j’y ai interviewé plus de 400 personnes, aussi bien dans la capitale animée que dans des zones si reculées que les enfants n’avaient jamais vu de Blanc. Mais, jusqu’à ce que je commence à me concentrer sur la paix plutôt que sur la guerre et sur le succès de sa construction plutôt que sur son échec, il ne m’était jamais venu à l’esprit de passer du temps à Idjwi. Lorsque j’ai visité l’île en 2016, puis à nouveau en 2019 et 2021, mes interlocuteurs ne m’ont pas raconté le dernier massacre ou les derniers combats qu’ils avaient subis, comme ils le font si souvent dans les régions de l’Est du Congo. Au contraire, ils vaquaient sans crainte à leurs occupations quotidiennes. Débarrassés de cette peur qui règne dans les provinces voisines et que j’avais vue et ressentie à quelques kilomètres de là.
Je me rends régulièrement au Congo depuis 2001. J’en ai parcouru toutes les provinces les plus violentes et j’y ai interviewé plus de 400 personnes, aussi bien dans la capitale animée que dans des zones si reculées que les enfants n’avaient jamais vu de Blanc. Mais, jusqu’à ce que je commence à me concentrer sur la paix plutôt que sur la guerre et sur le succès de sa construction plutôt que sur son échec, il ne m’était jamais venu à l’esprit de passer du temps à Idjwi. Lorsque j’ai visité l’île en 2016, puis à nouveau en 2019 et 2021, mes interlocuteurs ne m’ont pas raconté le dernier massacre ou les derniers combats qu’ils avaient subis, comme ils le font si souvent dans les régions de l’Est du Congo. Au contraire, ils vaquaient sans crainte à leurs occupations quotidiennes. Débarrassés de cette peur qui règne dans les provinces voisines et que j’avais vue et ressentie à quelques kilomètres de là.
Ce qui frappe à Idjwi, ce ne sont pas les villages détruits, séquelles trop fréquentes de la guerre dans les provinces du Kivu, mais la beauté spectaculaire d’un paysage lacustre où pousse une végétation luxuriante. Si la pauvreté rn’était pas aussi visible – dans les haillons des enfants, les maisons délabrées, les coupures de courant constantes, la rareté des articles sur les marchés -, Idjwi pourrait ressembler à un petit paradis. Grande comme Malte, elle offre un cadre écologique varié, occupé par diverses communautés ethniques et différents groupes politiques. On y croise des gens chaleureux aux tenues éclatantes de couleurs qui se partagent les chemins de terre avec des chèvres, des poulets, des chiens et parfois des cochons plutôt qu’avec des voitures : à peine une douzaine d’automobiles circulent sur l’île. Partout la musique résonne, souvent sortie de radios poussées à plein volume, mais aussi lors des fêtes, rythmée par des tambours traditionnels qui font chalouper les corps… Ici on danse en paix.
Il se peut que les conditions de vie sur Idjwi vous paraissent lointaines, et il y a de fortes chances pour que vous lisiez ce livre loin, très loin du Congo, Pourtant, nous – vous et moi – avons avec les Congolais une préoccupation commune. Ils sont confrontés à des défis similaires à ceux que nous connaissons à Paris, Baltimore, Rio de Janeiro et ailleurs : eux aussi veulent réduire les tensions communautaires et prévenir la violence.
Au Congo comme dans de nombreuses autres régions du monde, cette harmonie tant désirée ressemble souvent à une chimère. L’histoire atypique d’Idjwi nous prouve pourtant le contraire. Elle nous montre comment les ressources d’une communauté locale peuvent s’avérer plus « efficaces contre les conflits que les interventions lancées du sommet. Elle nous montre aussi l’importance de mettre les populations locales aux commandes pour générer la paix. Elle nous montre que rien n’est impossible.
Au cœur du conflit congolais
Pour comprendre à quel point cette île est extraordinaire, il faut revenir sur la combinaison de facteurs locaux, provinciaux, nationaux, régionaux et internationaux qui a alimenté l’insupportable violence subie par le Congo ces trente dernières années.
Le pays a obtenu son indépendance en 1960 après soixante-quinze ans de domination coloniale belge, puis a connu cinq années de troubles suivies de trois décennies de dictature. Dans les années 1990, les tensions politiques, économiques, sociales et ethniques ont dégénéré en une série de guerres civiles et internationales qui ont fini par impliquer ses neuf États voisins ainsi que d’innombrables groupes rebelles.
De l’époque coloniale jusqu’à aujourd’hui, les luttes pour l’accès à la terre et au pouvoir ont nourri de nombreux conflits dans les provinces de l’Est et fait de cette région, où se trouve Idjwi, la plus violente du pays. De plus, des combattants burundais, rwandais et ougandais entrent régulièrement au Congo, s’alliant à l’armée nationale ou aux diverses milices pour contrôler des territoires, repousser des ennemis et, parfois, faire la guerre à leur pays d’origine. Tous ces groupes exploitent illégalement les énormes ressources naturelles du pays – charbon de bois, diamants, or – pour financer leurs opérations.
Venue de toutes parts et décuplée par des réactions en chaîne, la violence frappe toute la société. À quelques heures d’Idjwi, sur le continent, des habitants rencontrés au marché local de Kavumu m’ont révélé craindre d’être assassinés dans leur sommeil pour quelques dollars gagnés la veille. Les parents redoutent constamment que leurs petites filles soient kidnappées, violées et soumises à des mutilations génitales, comme ce fut le cas pour quarante-six enfants de leur village entre 2013 et 2016. Dans tout l’Est du Congo, on m’a répété ces mêmes histoires de meurtres, de torture et de désespoir.
Sans surprise donc, les Congolais classent systématiquement la paix et la sécurité en tête de leurs priorités. Les questions universelles comme la pauvreté et le chômage, le manque d’accès à l’éducation, à la nourriture et à la terre, ainsi que les problèmes de gouvernance, notamment la corruption et l’injustice, entrent également au palmarès de leurs préoccupations.
Le Congo est le treizième pays le moins développé du monde. Concrètement, voici ce que cela signifie si vous naissez là-bas : dès votre petite enfance, il y a de forts risques que vous n’ayez pas assez à manger, comme plus de 40 % des enfants de moins de cinq ans qui souffrent de malnutrition. Un peu plus tard, vous devrez peut-être travailler pour survivre ou aider votre famille, ce que font 15 % des jeunes entre cinq et dix-sept ans. Vous irez à l’école pendant sept ans en moyenne, mais avec peu de chance d’atteindre le secondaire que seuls à peine plus de 50 % des Congolais peuvent fréquenter. Adulte, vous vivrez avec moins de deux dollars par jour comme 77 % de vos concitoyens. Et si vous êtes une femme, vous subirez probablement une forme de violence sexuelle, à l’instar de 51 % des Congolaises, Enfin, quel que soit votre sexe, vous ne mourrez pas très vieux : sachez que votre espérance de vie est d’environ soixante ans.
De nombreux Congolais apprennent à ne pas dépendre de l’État. Et pour cause : il est à peine présent en dehors des grandes villes, ce qui veut dire que dans beaucoup de campagnes on ne trouve pas d’écoles, pas de centres de santé, pas de forces armées fiables et pas de routes, sauf lorsqu’un donateur ou une association étrangère décide d’apporter son aide. Cette absence des pouvoirs publics nourrit une véritable défiance des populations : 70 % des Congolais déclarent se méfier profondément de leur gouvernement. Un sentiment que manifestent régulièrement mes amis lorsqu’ils traversent la rue pour ne pas croiser soldats et policiers, car ils voient plus souvent en eux des agresseurs que des protecteurs. À raison : jusqu’à récemment, les forces de l’ordre congolaises s’avéraient responsables de plus de viols, de meurtres et de pillages que les rebelles et les miliciens qu’elles combattaient.
Seul un gouvernement national concentré sur la paix et le développement pourrait relever ces défis, mais l’écrasante majorité de l’élite qui se dispute le pouvoir n’en a cure. Ses propres intérêts – richesse, influence et autorité – passent largement avant le bien-être des citoyens. En outre, Kinshasa, la capitale, est trop déconnectée du reste du pays pour que le gouvernement central puisse se montrer efficace, même s’il le voulait. La chronique politique congolaise de ces vingt dernières années rend compte de cette faillite : aucune des élections générales n’a jamais pu faire émerger un leadership national dévoué à la stabilité et au progrès. En 2006, le Congo a organisé son premier scrutin démocratique depuis son accès à l’indépendance en 1960. Joseph Kabila a été élu. Les citoyens congolais ont de nouveau voté en 2011 et, même si des accusations de fraude ont entaché le processus, Kabila et son parti ont remporté une deuxième fois la majorité des voix et le pouvoir présidentiel. De nouvelles élections générales devaient avoir lieu en 2016, mais le président les a repoussées à de multiples reprises et sous divers prétextes. Chacun de ces reports a généré des protestations populaires massives, qui ont été violemment réprimées. Le régime de Kabila a harcelé, menacé et parfois arrêté, torturé et tué des figures de l’opposition et des militants de base afin de supprimer toute résistance. Pendant des années, les gens ordinaires n’osaient plus discuter publiquement des élections. Lors de mes visites en 2016 et 2017, la plupart de mes amis et collègues baissaient la voix lorsqulils parlaient de la crise politique ; d’autres commençaient par regarder autour d’eux pour s’assurer que personne ne les écoutait…
La violence parasite tout le jeu démocratique. Elle musèle la liberté d’expression et limite celle de mouvement, conditions nécessaires à des élections équitables. Dans une relation perverse, la persistance de bandes criminelles et de groupes armés sert aussi l’appareil dirigeant. Ce dernier peut ainsi justifier la répression et imputer disparitions et meurtres à ses ennemis… Beaucoup de citoyens avaient nourri l’espoir d’en finir avec ce trouble jeu et l’incurie du gouvernement, quand, en 2018, une majorité d’entre eux a voté pour des opposants politiques. Las, le camp de Kabila a manipulé les résultats afin d’installer un président influençable, Félix Tshisekedi, qui, à coups d’alliances et de compromis, a replacé le pouvoir entre les mains des anciens dirigeants durant les premiers temps de son mandat. En somme, au Congo, les élections n’ont jamais produit un semblant de démocratie, mais ont engendré une violence massive. La plupart des Congolais considèrent que les affaires électorales, les questions de paix et de sécurité et les problèmes économiques sont inextricablement liés. À l’approche du scrutin, les politiciens mobilisent leurs soutiens en essayant souvent d’acheter leurs voix avec des promesses de terres, d’argent, de travail ou d’autres avantages, et en les opposant aux partisans de leurs adversaires. C’est un marchandage dont les citoyens sortent toujours perdants. Dans de nombreuses villes et villages que j’ai visités, les habitants ne cessaient de demander des programmes de développement qui offriraient des opportunités de travail à leurs fils, neveux, voisins – voire à eux-mêmes – afin qu’ils ne rejoignent pas les groupes armés. Et de nombreux miliciens abondaient dans le même sens quand ils m’expliquaient les motivations pratiques de leur engagement : à défaut d’un emploi, un fusil leur permettait de survivre. De plus, il forçait le respect et leur donnait un pouvoir dont ils n’avaient jamais joui auparavant… Cette logique débouche sur une impasse, car la violence que ces rebelles entretiennent en portant les armes les prive eux aussi d’initiatives de développement et donc de nouvelles possibilités de travailler pacifiquement et de réussir une vie différente. Ils sont eux-mêmes happés par l’engrenage qu’ils actionnent.
Ce type de cercle vicieux n’est pas propre au Congo. Je l’ai observé en Colombie, en Irlande du Nord, au Somaliland et au Timor oriental. Je l’ai trouvé particulièrement saillant dans les Territoires palestiniens lors de mes visites en 2012 et en 2018. Là-bas, militants et fonctionnaires ne cessaient de déplorer la diminution constante des fonds alloués aux écoles et à l’activité économique dans les camps de réfugiés, ce qui laissait les jeunes inoccupés et sans avenir, les transformant en recrues faciles pour les mouvements terroristes.
Sous d’autres latitudes, des pays apparemment pacifiques subissent la fatalité de ce même schéma. Aux États-Unis par exemple, le grand nombre de fusillades dans certains quartiers fait fuir les entreprises potentielles, ce qui prive les habitants d’opportunités économiques et accroît leur désespoir. Sans perspectives d’emploi légaux, les jeunes s’engagent dans le monde de la drogue et des gangs, et la violence armée s’en trouve encore exacerbée…
Reste alors ma question : face à un État dysfonctionnel, un gouvernement autoritaire, une pauvreté extrême, des pays voisins agressifs et une multitude de tensions locales, nationales et régionales, comment les habitants d’Idjwi ont-ils réussi à maintenir la paix?
La réponse dans le livre de Séverinne Autessere Sur les fronts de la paix





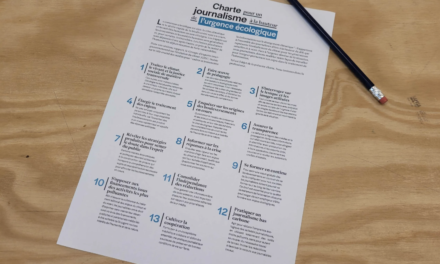


Commentaires récents